
De « Patria o muerte » à « Allahou Akbar », le manifeste décolonial d’Houria Bouteldja – Préface de Ramon Grosfoguel pour l’édition espagnole
Publié le 8 février 2018 sur le site du PIR.
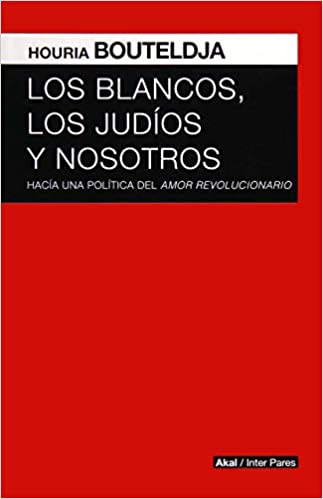
Préface de l’édition en espagnol du livre de Houria Bouteldja « Les Blancs, les Juifs et Nous : Vers une politique de l’Amour Révolutionnaire » (Akal, Barcelone, 2017)
« Écoute, Blanc ! », ici tu trouveras les clés de ta propre décolonisation et de ta libération du piège dans lequel t’a pris la civilisation capitaliste, impérialiste, patriarcale, occidentalocentrée, christianocentrée, moderne, coloniale, et l’auteure de ce livre te fait une proposition « amoureuse » indispensable (si tu veux vraiment sortir des guerres et de l’enfer où nous nous trouvons). Bien qu’il s’agisse d’un texte écrit dans le contexte français, il présente des leçons implacables pour les espaces métropolitains impérialistes ou pour les espaces périphériques néocolonialistes où la suprématie blanche s’est matérialisée. Si la modernité occidentale comme projet civilisationnel produit des privilèges pour les Blancs métropolitains –tandis qu’elle génère en même temps des génocides, des épistémicides, des écocides et de la mort pour le reste des vies (humaines et non humaines) sur la planète-, Houria Bouteldja se demande : « (…) qu’offrir aux Blancs en échange de leur déclin et des guerres qu’il annonce ? Une seule réponse : la paix, un seul moyen : l’amour révolutionnaire. Les lignes qui suivent ne sont qu’une énième tentative –sûrement désespérée- de susciter cet espoir ».
Il ne s’agit pas d’une autre déclaration typique des faux prophètes « new-age » où le mot « amour » entre dans le circuit mercantile du capitalisme et dans les codes de domination raciale de l’impérialisme, sinon d’une déclaration révolutionnaire qui implique la fin de la civilisation actuelle et la fondation d’une nouvelle civilisation à travers une révolution politique décolonisatrice. Pour paraphraser les zapatistes : si la civilisation présente produit un monde où seul un monde est possible et les autres impossibles, il s’agirait de produire une civilisation où d’autres mondes soient possibles et où ce monde ci devient impossible. Mais l’auteure ne laisse aucune échappatoire aux discours « d’innocence » qui ont toujours permis aux Blancs de droite et de gauche d’échapper à leur responsabilité historique. Pour Houria Bouteldja, le discours « d’innocence » est un des mécanismes produits par ce qu’elle appelle le champ politique blanc– champ qui va de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, en passant par tous les courants politiques au milieu, constitutifs de ce qu’elle appelle le système immunitaire blanc : « Moi je vous vois, je vous fréquente, je vous observe. Vous avez tous ce visage d’innocence. C’est là que réside votre dernière victoire, avoir réussi à vous exonérer de toute faute (…) Nous sommes coupables, vous êtes innocents (…) Vous êtes des anges parce vous avez le pouvoir de vous déclarer être des anges et celui de faire de nous des barbares. (…) L’indigène spolié est vulgaire, le Blanc spoliateur est raffiné. À un bout de la chaîne se trouve la barbarie, à l’autre la civilisation. C’est bon ce truc d’être innocent : ça permet de jouer la candeur, et d’être toujours du côte aimable… »
Les privilèges de la blanchité se construisent sur un système d’oppression impérialiste qui aveugle la majorité des Blancs quant aux oppressions qu’ils génèrent dans le reste du monde. Comme dit Houria du philosophe français le plus connu du XXe siècle -à propos de sa complicité envers le racisme génocidaire que le colonialisme sioniste exerce contre le peuple palestinien : « Se résoudre à la défaite ou à la mort de l’oppresseur, fût-il juif. C’est le pas que Sartre n’a pas su franchir, c’est là sa faillite. Le Blanc résiste (…) Sartre mourra anticolonialiste et sioniste. Il mourra Blanc. Sartre n’a pas su être radicalement traître à sa race. Il n’a pas su être Genet… »
Il ne s’agit pas non plus d’une politique sectaire essentialiste «anti-blanche» qui ne permettrait pas d’alliances avec la gauche blanche. L’invitation à une alliance politique est toujours ouverte dans ce manifeste décolonial et dans la pratique politique des mouvements décoloniaux. Mais pour avancer vers une alliance politique, il faut auparavant créer des mouvements décoloniaux autonomes qui génèrent la force politique qui permettra de négocier à partir d’une position de force. Voilà la clef du succès de tout mouvement de sujets racialisés. Selon Abdelmalek Sayyad, penseur décolonial algérien cité dans ce livre, « exister, c’est exister politiquement». Sans politique décoloniale autonome, il n’y a pas de révolution décoloniale, et sans alliances politiques au-delà des forces politiques décoloniales, la transformation civilisatrice qu’exige le projet politique décolonial n’est pas possible. Ceci n’est pas une constatation rhétorique, c’est essentiel pour la politique décoloniale. Faire de la politique ce n’est pas se manifester sur Facebook par des insultes et des attaques quotidiennes contre tout le monde ; Si cela peut servir de thérapie individuelle, cela n’a rien à voir avec la pratique politique décoloniale. La révolution décoloniale demande une transformation révolutionnaire de la subjectivité, des paradigmes, de l’éthique et des structures de domination. Attaquer les autres par des insultes n’a rien à voir avec la politique de l’amour révolutionnaire dont Houria Bouteldja parle dans ce livre.
Une mise au point: la « gauche blanche » existe aussi bien en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, qu’en Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes, parce que n’est pas une couleur de peau qui est en jeu, mais une épistémologie, une pratique politique, une manière eurocentrée de voir, de penser et d’être dans le monde. On peut être noir, métis, indigène ou asiatique et faire partie de la gauche blanche. Mais le point crucial ici c’est qu’il ne peut pas y avoir d’alliance politique dans la dignité sans critique de l’eurocentrisme, du colonialisme et du racisme que produit le paternalisme condescendant de la gauche blanche envers les sujets racialement infériorisés. Par exemple, nous assistons aujourd’hui au conflit en Bolivie et en Équateur entre les mouvements indigènes du « Bien Vivre » (Buen vivir) et la gauche occidentalisée qui gère les États dont l’horizon de lutte est le « développementisme » et « l’extractivisme » (des minerais et richesses du sous-sol). La gauche blanche, confrontée à ce choc de projets politiques se comporte de manière condescendante et paternaliste face aux revendications du mouvement indigène et elle va parfois même jusqu’à la répression. De la même manière, nous observons les difficultés de la gauche blanche dans ses rapports avec les sujets racialisés dans leurs propres territoires. En même temps, l’alliance avec la gauche blanche est plus que fondamentale, elle est indispensable. Sans racialisés décoloniaux il n’y a pas de révolution décoloniale, mais sans Blancs décoloniaux non plus. Sadri Khiari, théoricien et militant du PIR, le Parti des Indigènes de la République, l’un des auteurs les plus cités dans ce livre affirme ainsi que: « Parce qu’elle est la partenaire indispensable des indigènes, la gauche est leur premier adversaire ».
Mais pareillement nous pouvons affirmer que ce livre nous dit aussi : « Écoute colonisé! » ; « Écoute Indigène ! » ; « Écoute Noir ! » ; « Écoute Gitan ! » ; « Écoute Arabe ! » ; « Écoute Juif ! » ; « Écoute … ! ». Ici se trouvent aussi les clés de leur libération. Ne manquez pas de lire ce manifeste décolonial pour le XXIe siècle dans la meilleure tradition de Frantz Fanon, Sylvia Wynter, Aimée Césaire, Kwame Nkruma, Leila Khaled, Amilcar Cabral, Angela Davis, Gloria Anzaldúa, Ali Shariati, Malcom X, Audre Lorde, James Baldwin, Jean Genet, Ella Shohat et tous les combattantes et combattants décoloniaux du XXe siècle. L’auteure ne ménage pas non plus les sujets colonisés et elle dénonce l’absurdité et la limitation des multiples subterfuges et chemins du leurre (de soi) que produit la stratégie qui consiste à essayer de se blanchir. Il n’y a rien à gagner -et beaucoup à perdre- dans les projets mimétiques du blanchissement mental, existentiel, politique et/ou épistémique : imitation des modèles occidentalocentriques, assimilation culturelle aux valeurs occidentales ou internalisation de l’eurocentrisme épistémique de gauche ou de droite.
Peut-être devrait-on dire : « Écoute occidentalisé ! » pour parler des Blancs et non-Blancs, tous ceux d’entre nous qui avons internalisé l’occidentalisation dans nos corps et nos esprits. En effet, dans ce livre, personne n’est épargné : ni la gauche blanche, ni le féminisme, ni le mouvement LGBT, ni les sujets colonisés eux-mêmes, ni les populations racialement infériorisées dans les métropoles, qu’elle appelle « indigènes aristocrates »; ni les mouvements de libération nationale du XXe siècle, ni le socialisme du XXe siècle, ni les Juifs qui ayant échappé à l’Holocauste allemand/occidental recherchent leur salvation dans le sionisme contemporain, ni l’islamisme politique, ni la social-démocratie, ni les néofascistes, ni la droite classique, ni les anarchistes, etc. Enfin, les versions de droite ou de gauche de la modernité occidentale ne trompent pas l’auteure, ni les multiples mensonges impériaux de cette civilisation tels que les discours de « démocratie », « liberté », « droits humains », ou « civilisation » avec lesquels on justifie l’assassinat de millions d’êtres humains à l’échelle planétaire. Personne n’a une position commode parce que dans cette trame complexe que constitue la domination occidentale du monde, personne n’est innocent.
Pour l’auteure, ni les opprimés ni les oppresseurs ne s’en tirent à bon compte. Nous avons tous divers degrés de responsabilité, entre autres celle consistant à ne pas reproduire le relativisme impérialiste blanc qui dit que « tout se vaut » ou que « nous sommes tous également des opprimés » en essayant d’effacer les privilèges de la blanchité produits par les hiérarchies de domination, ni les universalismes occidentalocentriques coloniaux qui font des valeurs blanches des valeurs « universellement » supérieures pour justifier les hiérarchies entre les opprimés et les oppresseurs. Le « relativisme » et « l’universalisme » sont des stratégies d’évasion qui constituent les deux côtés de la même pièce du système immunitaire blanc. Le pluriversalisme en tant qu’universalisme décolonial constituerait une issue à ce dilemme.
Mais il ne s’agit pas non plus d’un livre qui critique sans laisser d’alternatives. La proposition que nous soumet l’auteure est d’une importance fondamentale. Pour sortir de la blanchité et de sa civilisation moderne occidentale composée par de multiples hiérarchies de domination à échelle planétaire, Houria Bouteldja propose un projet qui est simultanément antiraciste politique, féministe décolonial, anti-impérialiste radical, épistémiquement anti-eurocentrique, antisioniste et en même temps critique et intransigeant envers l’antisémitisme, et défenseur de l’amour révolutionnaire comme projet qui nous permettra la construction d’une nouvelle civilisation au-delà des logiques civilisationnelles de mort de la modernité occidentale. C’est-à-dire qu’il s’agit de construire un projet politique anti-systémique pour la fondation d’une nouvelle civilisation plus juste, plus démocratique et respectueuse de la vie du point de vue écologique.
Il ne suffit plus de dire que « Nous sommes anticapitalistes ». Si le capitalisme est raciste, génocidaire, patriarcal, epistémicidaire, écocidaire, eurocentré, etc. c’est parce qu’il est organisé et traversé de l’intérieur par les logiques civilisationnelles de la modernité occidentale. Le capitalisme n’est pas le fondement du système comme le dit la gauche blanche. Le capitalisme historique est la structure économique de quelque chose de plus fondamental : la civilisation moderne occidentale et ses multiples hiérarchies de domination. La civilisation-monde moderne occidentale est le fondement du capitalisme historique et non pas l’inverse. Dans le tournant décolonial, c’est la modernité et ses multiples hiérarchies de domination à l’échelle mondiale qui constituent le fondement de la civilisation-monde dans laquelle nous sommes plongés et qui est devenue planétaire en détruisant toutes les autres civilisations. Comme dit l’auteure, si la gauche blanche «nous parle d’expansion capitaliste, par conséquent de lutte de classes sociales, nous répondons: expansion coloniale, par conséquent lutte de races sociales».
Après plusieurs siècles d’expansion coloniale européenne à partir de 1492, toutes les civilisations existantes avec leurs différentes formes d’économie, d’autorité politique, d’idéologies, de cosmovisions, de manière d’être en rapport avec d’autres formes de vie, de technologies plus écologiques, de manières plus égalitaires dans les relations de classe, de genre et de sexualité, etc. ont été détruites et la civilisation de mort qui est la nôtre aujourd’hui s’est imposée. C’est pourquoi dans la perspective du tournant décolonial cela ne fait aucun sens de parler de «choc de civilisations» (projet de la droite pro-impérialiste blanche), de « lutte anticapitaliste » (projet de la gauche radicale blanche), ni de « lutter pour plus de modernité » (projet de la social-démocratie blanche).
Le « choc de civilisations » est une grande fiction parce qu’aujourd’hui il n’existe qu’une seule civilisation planétaire. Il n’y a aucun sens non plus à parler d’une «lutte anticapitaliste» exclusive qui ne remettrait pas en question le projet civilisationnel de la modernité parce qu’on finirait par reproduire à nouveau tout ce contre quoi on lutte. C’est ce qu’a montré l’échec du socialisme et des mouvements de libération du XXe siècle qui finirent par être des projets eurocentriques qui reproduisirent le paradigme de la gauche occidentalisée en proposant une lutte centrée contre le capitalisme sans remettre en question les hiérarchies de domination raciales, patriarcales, eurocentriques, cartésiennes, écologiques, pédagogiques, épistémologiques, christianocentriques, etc. de la modernité. Il s’agissait de projets « anticapitalistes modernes » ou « anticapitalistes eurocentriques » qui se battaient pour un grand mensonge appelé « modernité anticapitaliste ». Je dis « mensonge » parce que la modernité produit le capitalisme historique réellement existant et si on ne développe pas une lutte anti-systémique contre les hiérarchies de domination de la modernité, on finit par reproduire les mêmes hiérarchies contre lesquelles on se bat, y compris le capitalisme historique dans sa forme de capitalisme d’État, comme cela est arrivé avec le socialisme du XXe siècle. La modernité n’existe pas sans capitalisme historique, et il n’y a pas de lutte anticapitaliste qui puisse sauver la modernité. En fin de compte, la lutte de la droite classique pour « plus de modernité » ne nous est pas nécessaire parce que la modernité n’est pas un projet d’émancipation, mais un projet de civilisation responsable du désastre planétaire actuel. Par conséquent, on n’a pas besoin de cette modernité, ni de postmodernité parce que les deux constituent des projets qui sont une critique eurocentrique à l’eurocentrisme qui maintient intact le système civilisationnel de la modernité occidentale.
Il ne s’agit pas non plus d’avoir une vision romantique du passé et de retourner dans un passé idyllique prémoderne, ce qui est impossible… Ce qui est proposé est un projet politique au-delà de la modernité ou comme le dit Enrique Dussel, philosophe de la libération latino-américain, un projet vers la « transmodernité » à partir de la diversité épistémique du monde. Voilà l’invitation que nous font tous les penseurs décoloniaux hommes et femmes y compris l’auteure de ce livre. Ce projet n’est pas un projet sur quelques années, ni même quelques décennies. Il s’agit d’un projet à long terme, sur un ou deux siècles. Si le projet civilisationnel de la modernité a eu besoin de plusieurs siècles pour se former et se consolider, la transmodernité prendra également quelques siècles à se former et à se consolider. La politique décoloniale a aujourd’hui la transmodernité comme horizon de lutte à long terme et la lutte contre les hiérarchies de domination de la modernité occidentale comme horizon de lutte à moyen et court terme. Tant et si bien que si la transmodernité est un projet dont la temporalité est de longue durée, elle demande comme condition la lutte anti-systémique aujourd’hui, dont la temporalité est de moyenne durée.
Houria Bouteldja est une des activistes et penseuses décoloniales les plus importantes de notre temps. Elle est porte-parole du Parti des indigènes de la République (PIR) en France. Le PIR est un mouvement décolonial autonome qui lutte pour la décolonisation de la France en appelant au plan national à un « internationalisme domestique » et au plan international à un « internationalisme décolonial ». Le cri musulman Allahou Akbar avec lequel se termine le livre est une critique du mythe séculier/religieux de la modernité et a pour signification : Allah est le/la plus grande parce que c’est la force créatrice de vie dotée d’intelligence qui est au-delà de tout ce monde terrestre éphémère et contingent. C’est une force qui se trouve plus haut que ce que n’importe quel être humain peut atteindre. Cette invocation est un appel à l’humilité contre l’arrogance des égos conquérants occidentalisés et surtout un appel à n’idolâtrer/fétichiser/sacraliser aucun pouvoir terrestre. C’est une critique de l’idolâtrie et du fétichisme que les pouvoirs terrestres produisent en se sacralisant. Allahou Akbar est un appel à désacraliser tous les rapports de domination qui nous entourent -des pharaons aux empires et à l’État-nation moderne. Comme dit Enrique Dussel dans sa théologie de la libération, la condition de possibilité de la critique radicale c’est d’être athée face à tout pouvoir terrestre. Si on sacralise l’Empire, on est un croyant du dieu des oppresseurs. La critique de la modernité est aussi une critique radicale du faux sécularisme qui tente de nous éloigner d’Allah, de la Pacha ou de l’Ubuntu comme principes cosmologiques holistiques de la production et reproduction de la vie, pour les remplacer par les faux dieux de la modernité, comme le capital, l’État moderne, l’Empire, l’homme blanc, le dualisme cartésien, la science moderne, la culture/valeurs/épistémologie occidentales et le dollar/euro, toutes divinités destructrices de la vie. La critique décoloniale est surtout une critique aux dieux de la religion planétaire la moins reconnue : le culte de la modernité.
La modernité crée toujours l’idée de « peuples à problèmes » – « le problème juif », « le problème indien », « le problème noir », « le problème musulman », tandis que les dieux de la modernité sont proposés comme « solution ». Houria Bouteldja nous rappelle que le problème, c’est la modernité elle-même et non les peuples qu’elle rend inférieurs. On ne peut pas être décolonial si on idolâtre encore la modernité et si on la considère comme un projet à imiter dans l’illusion qu’elle est un projet d’émancipation. La modernité est avant tout un projet civilisationnel colonial de mort. Le mode binaire séculier/religieux est le mythe imposé par la civilisation moderne occidentale dans ses projets coloniaux pour détruire les spiritualités/savoirs/épistémologies des peuples dans le but de faciliter l’imposition des faux dieux de la modernité. Si la modernité dans son expansion coloniale a désenchanté le monde, la décolonisation transmoderne veut dire le ré-enchanter.
Une autre mise au point : indigène dans ce livre est le terme qui fut utilisé par l’empire français pour nommer tous les peuples dominés et exploités dans les colonies. Si bien que le terme ne fait pas uniquement référence aux peuples originaires, sinon à tous les peuples colonisés par l’empire français, des Vietnamiens aux Antillais. En espagnol, il serait plus adéquat de traduire « indigènes » tel qu’il est utilisé dans ce livre comme l’équivalent des « sujets coloniaux ». Le PIR emploie le mot « indigène » comme une identité politique pour nommer toutes les populations qui, bien que nées et/ou élevées en France, sont encore racialement infériorisées. Les indigènes d’aujourd’hui vivent dans des conditions indignes semblables à celles de l’époque du colonialisme français quand les lois racistes de l’ « indigénat » étaient en vigueur. Le slogan du PIR c’est « nous sommes les indigènes de la république française » pour dénoncer que nous continuons à vivre sous le joug du racisme colonial, même si les administrations coloniales ont disparu sur la plus grande partie de la planète et même si nous vivons à l’intérieur de la République française qui se réclame de la défense des droits humains, de la liberté individuelle et des droits civiques. L’hypocrisie de ces discours est évidente. Ces droits sont reconnus aux populations blanches de la république et sont quotidiennement mis à mal chez les non-blancs. C’est-à-dire que pour le PIR la catégorie « indigène » désigne une identité politique et non une identité essentialiste/culturaliste. Les sujets raciaux/coloniaux à l’extérieur (néocolonialisme) et à l’intérieur (colonialisme interne) des centres métropolitains continuent à vivre sous le joug du racisme de la colonialité du pouvoir.
Si l’exploitation de classes produit la lutte de classes sociales et la domination de genre produit la lutte de genres sociaux, la domination raciale produit une lutte de races sociales. Qu’importe le nombre de fois où Houria Bouteldja a expliqué que les « races » sont des constructions politiques/sociales et que des catégories identitaires comme « Blanc », « Noir », « Indigène », « Indien », etc. font partie intégrante d’un système de domination raciale, encore aujourd’hui il se trouve des gens qui par erreur ou par mauvaise foi continuent à lire dans ses écrits un réductionnisme épidermique ou un essentialisme réductionniste. L’antiracisme qui est défendu dans ce livre n’est pas un antiracisme moral, mais un antiracisme politique parce que le racisme est toujours institutionnel, structurellement imbriqué dans des hiérarchies de domination de genre, de classe, épistémologiques, pédagogiques, spatiales, écologiques, religieuses, etc.
L’emploi de « décolonialité » aujourd’hui n’est pas réductible à un projet d’ « indépendance » et de « souveraineté » face à une administration coloniale comme on l’entendait aux XIXe et XXe siècles. C’est cela et beaucoup plus parce que la colonialité étant le côté sombre de la modernité, elle possède une multiplicité de hiérarchies de dominations qui ne se réduisent pas au colonialisme. Décolonialité n’est plus le cri séculier/moderne de « Patria o muerte » pour la création d’un État-nation. Créer des États-nations c’est répéter l’autorité politique de la modernité dont la prétention est de produire une correspondance parfaite entre l’identité de l’État et l’identité des populations sur son territoire. Cette fiction n’existe nulle part et elle a créé plus de problèmes que de solutions là où elle s’est imposée. D’où la lutte décolonisatrice des peuples indigènes des Amériques pour constituer des États plurinationaux comme réponse aux problèmes des États-nations. Mais si le « plurinationalisme » s’oppose bien radicalement à l’assimilationnisme, il n’est pas non plus l’équivalent du « multiculturalisme libéral » où le pouvoir central de la nation blanche dominante laisse quelques miettes aux groupes infériorisés racialement ou aux nations sans État pour qu’ils sautent et dansent dans leur « carnaval » à condition qu’ils ne remettent pas en question qui commande. Le « multiculturalisme libéral » est une reconnaissance culturaliste superficielle des identités opprimées, mais sans changer les hiérarchies de domination. Le concept de plurinationalité des mouvements indigènes latino-américains est très différent : c’est la reconnaissance horizontale et sans hiérarchies du fait que nous sommes des nations multiples qui coexistent dans un seul État qui doit alors se structurer comme un État plurinational. Il s’agit d’une reconnaissance de l’autodétermination et de la souveraineté populaire de chaque nation sans que l’une ne s’impose à l’autre. Pour cela il est fondamental de partir de la différence épistémique de chaque nation pour, au-delà, construire des possibilités de vivre ensemble, en respectant les différences. La reconnaissance de la souveraineté populaire peut résulter en la création d’États indépendants qui ne reproduisent pas à nouveau le concept moderne/colonial d’État-nation ou qui résulte en la décolonisation des États-nations actuels vers des structures plurinationales sur leur territoire où tous commandent en obéissant à leurs communautés respectives. En résumé, l’État-nation dans son volet assimilationniste ou multiculturel libéral est la structure par excellence d’autorité politique de la modernité où celui qui commande, commande sans obéir aux communautés. Décoloniser l’autorité politique de la modernité signifie organiser des États plus communautaires, plus communaux, plus démocratiques et participatifs, au-delà de la prison de l’État-nation.
D’autre part, Houria Bouteldja nous rappelle aussi que si tous les anti-impérialismes et anticolonialismes ne sont pas décoloniaux, tout décolonial doit être avant tout radicalement anti-impérialiste et anticolonialiste. Cependant, le « décolonial » devient une mode. Il y a aujourd’hui des « décoloniaux » mal nommés qui sont très coloniaux dans la mesure où ils ne sont pas radicalement anti-impérialistes ni anticolonialistes, comme le montre le débat sur le Venezuela. Ils répètent les thèses coloniales de la droite néolibérale pro-impériale mais de manière plus perverse parce qu’ils le font au nom d’une vision faussement « décoloniale ». Mais il existe aussi des « décoloniaux » qui tentent d’éliminer l’antiracisme politique radical de la vision décoloniale. La décolonialité sans antiracisme politique, c’est comme le café sans caféine ou des rayons sans miel. Au fond, ces manifestations « décoloniales-coloniales » ou « colonialistes-décoloniales » sont le fait de libéraux qui pensent à partir de catégories comme l’individu atomisé, la démocratie libérale et les libertés individuelles dont jouissent les Blancs sur la base de la domination et de l’exploitation du reste de l’humanité. Réduire des identités et des groupes, qui se sont toujours constitués dans la réalité sociale comme des collectifs, en individus atomisés est un des grands mythes du libéralisme comme idéologie dominante de la civilisation-monde moderne occidentale.
Dans ce livre, Houria Bouteldja déclare la guerre ouverte au libéralisme en tant que l’un des mécanismes par excellence de l’impérialisme pour rendre invisible la domination raciale á l’échelle planétaire. Le système impérial est organisé à travers la suprématie blanche. Si la domination raciale imbriquée dans le système impérialiste mondial produit d’un côté les « damnés de la terre », de l’autre elle produit simultanément les « fortunés de la terre ». Les privilèges raciaux des uns sont produits par la violence et la dépossession des autres. La richesse pour les uns signifie la pauvreté pour les autres. La démocratie pour les uns se fabrique à travers la violence, le vol et le despotisme exercés sur les autres. Les libertés et droits individuels libéraux qu’octroient les privilèges de la blanchité pour quelques-uns sur la planète sont produits à travers l’autoritarisme et le saccage exercé sur les autres majoritaires. Les États libéraux occidentaux ne sont pas des démocraties mais des ploutocraties qui vivent du vol à échelle planétaire. Il n’y pas de demi-mesures ni de fausses solutions dans ce livre. S’il provoque répugnance et indignation chez le lecteur, si ce dernier est scandalisé par ce qu’il dit, s’il provoque la nausée, alors que le lecteur ne se trompe pas, c’est la voix du Blanc qu’il porte en lui qui proteste. Et, face à cette voix intérieure, j’entends Houria Bouteldja qui nous dit : pour une politique de l’amour révolutionnaire qui donne priorité au bien de l’humanité, trahissez-la !
Par Ramón Grosfoguel
Traduit par Laurent Cohen Medina
